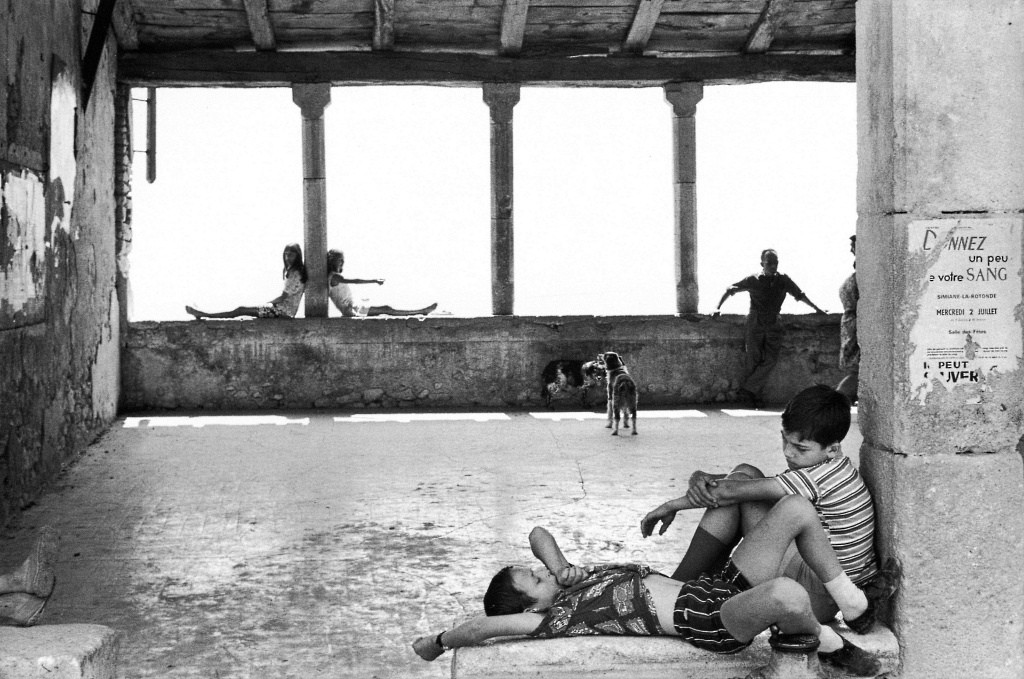Musée de la Vie Romantique – Exposition « Visages de l’effroi. Violence et fantastique de David à Delacroix » (novembre 2015 – février 2016)
Comment représenter la mort ? Comment saisir ce qu’on ne peut connaître sans disparaître, ce dont personne n’est jamais revenu ? Comment regarder ce qu’on ne peut voir sans perdre la vue ou la vie ?
L’artiste s’y essaie, inévitablement, s’y brûle, pour rappeler aux vivants ce qu’ils veulent oublier ou pour apprendre à mourir, en philosophe. Et quand il est trop tard et qu’on ne peut plus rien faire, il nous aide à pleurer les morts.
Dans cette descente aux enfers, le rêve se mêle au cauchemar, l’art à l’horreur. Les monstres infernaux ouvrent les portes de leurs ténèbres et nous y laissent s’y enfoncer. Comme Orphée, on voudrait ramener les morts à la surface, à la vie. Mais empli de la joie de retrouver sa bien-aimée ou terrifié par le silence que ne couvrent plus ses pas, Orphée se retourne. Sa belle défunte disparaît alors devant ses yeux, définitivement, et son regard ne trouve plus que le noir. Ainsi le chant d’Orphée nous laisse inconsolables : personne ne revient de la mort.
(Emile Mascre, Capet, Lève-toi !, 1833-1834, huile sur toile)
Dans cette peinture, la frontière reste infranchissable entre le monde des vivants, en couleurs, et celui, déjà blême, des morts.
On est au XIXème siècle, au cœur du triomphe de l’industrialisation et de la rationalité, mais derrière ce rideau du « progrès », s’étend l’ombre de faits divers glauques, de crimes passionnels et assassinats politiques, comme se répand la tâche de la Révolution française ou des guerres napoléoniennes.
Même dans les avancées de la médecine en connaissance de l’anatomie ou de la psychiatrie sur les maladies mentales, les artistes rendent hommage moins à la raison qu’à la folie, à l’irrationnel. La Mélancolie, mal du siècle, nourrit un romantisme noir.
 Dans ce tableau de Charles Desains, cette « femme asphyxiée » (1822) est-elle une vision fantastique, une aliénée qui cherche à quitter sa cellule où on l’a enfermée de force, une amoureuse désespérée ?
Dans ce tableau de Charles Desains, cette « femme asphyxiée » (1822) est-elle une vision fantastique, une aliénée qui cherche à quitter sa cellule où on l’a enfermée de force, une amoureuse désespérée ?

Léon Cogniet, « Têtes de femme et d’enfant », esquisse pour la « Scène du massacre des Innocents », 1824
Le musée de la Vie romantique a revêtu ses habits de deuil.
On y entre comme dans un lieu sacré, dans le silence qu’inspire l’au-delà.
Au mur, des tableaux-tombeaux figurent la mort qui guette, qui gagne les visages et morcelle les corps.
En contemplant David, Delacroix, Géricault et Ingres, on se rappelle ce que Le Caravage disait, au début du XVIIème siècle :
« On peut vaincre la terreur par l’image de la terreur ».
Une victoire qui ne saurait être celle du guerrier, mais qui est celle de l’âme, apaisée par la vue de la beauté, même lorsqu’elle a la couleur du sang.